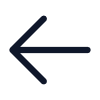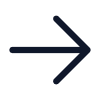Batsheva Dance Company
Tabula Rasa
Ohad Naharin
Arvo Pärt: Tabula Rasa
photo Gadi Dagon
source: batshevacoil
Batsheva Dance Company has been critically acclaimed and popularly embraced as one of the foremost contemporary dance companies in the world. Together with its junior Batsheva Ensemble, the Company boasts a roster of 34 dancers drawn from Israel and abroadץ Batsheva Dance Company is Israel’s biggest company, maintaining an extensive performance schedule locally and internationall with over 250 performances and over 75,000 spectators per year.
Hailed as one of the world’s preeminent contemporary choreographers, Ohad Naharin assumed the role of Artistic Director in 1990, and propelled the company into a new era with his adventurous curatorial vision and distinctive choreographic voice. Naharin is also the originator of the innovative movement language, Gaga, which has enriched his extraordinary movement invention, revolutionized the company’s training, and emerged as a growing international force in the larger field of movement practices for both dancers and non-dancers.
The Batsheva dancers take part in the creative processes in the studio and create themselves in the annual project “Batsheva Dancers Create” supported by The Michael Sela Fund for Cultivation of Young Artists at Batsheva.
Batsheva Dance Company was founded as a repertory company in 1964 by the Baroness Batsheva de Rothschild, who enlisted Martha Graham as its first artistic adviser. Since 1989, Batsheva Dance Company has been in residence at the Suzanne Dellal Centre in Tel Aviv.
.
.
.
.
.
.
.
source: annarogovoywordpress
Batsheva Dance Company in Tabula Rasa by Ohad Naharin, photo Gadi Dagon
Ohad Naharin’s Tabula Rasa and Sharon Eyal/Gai Behar’s Lost Cause begin the same way, with one dancer, alone (or seemingly so) onstage. This choice seems to send a clear message: consider the individual. Consider the dancer as a single unit, as an independent being. Remember, even during the most regimented unison phrases and interlocked partnering sequences to come, that all this is being performed by unique human beings.
The Batsheva Ensemble, which serves as a sort of junior wing to Naharin’s Batsheva Dance Company, is an internationally-sourced group of blazing, vigorous daredevils. Tabula Rasa contains mesmerizing how-did-she-get-up-there partnering and phrases that have the dancers floating for a moment inches from the floor before crashing down prone, and I did not see a moment of hesitation in Wednesday evening’s performance. These dancers are not waiting or holding back: their moment has come, they have arrived, and they give everything they have to the choreography, which in my opinion is some of Naharin’s finest. It occurred to me during one large ensemble section that had different groups of dancers executing different phrases, spatially interspersed amongst each other, that when working with so many bodies and so much movement, the phrases themselves need not be that complex. But they are. Naharin cuts no corners, cheats nowhere; every potentially unseen detail on the often-flooded stage is intentional and given its due weight and time. Chaotic patterns give way to structured patterns and shifts of direction happen in impossible blinks. Movement motifs appear–a particular phrase throwing arms and legs from side to side recurs, some spatial patterns emerge as particularly dominant–but the dynamic performances and crisp transitions keep Tabula Rasa surprising, even when we have watched every member of the company slowly rock from side to side across the entire stage.
I questioned the order of the program before even seeing Sharon Eyal and Gai Behar’s collaborative contribution, Lost Cause, which did not bode well. Naharin is a tough act to follow (in fact I’m not sure I’ve ever seen his work placed anything but last on a mixed bill), but I saw and very much enjoyed Eyal’s choreography two summers ago at Jacob’s Pillow and so I particularly regret how little I liked this piece. A couple of the dancers, Keren Laurie-Pardes and Mariko Kakizaki in particular, seem well suited to Eyal’s movement vocabulary, and most of the solo sections that emerge from ensemble sweeps of the stage are appealingly bizarre and sometimes endearingly awkward. But the overall feel is unpleasantly cold and a little formulaic, relying on pantomimed gestures to draw chuckles from the audience and familiar choreographic tropes (okay, everyone walk back and forth in a “wash”; now we’re going to do a robotic phrase in unison…) to engage the energy onstage. Laurie-Pardes’ final solo is undeniably great, her gangly limbs and spine capturing a tense, creaturely desperation, her gaze unwaveringly pinned outwards to the audience. I’m actually a little glad that I preferred the solos in this work to the larger sections, as I remember preferring the reverse in the last works of Eyal’s I saw, and it’s interesting to see the choreographer experimenting with her approach.
Lost Cause probably warrants a second viewing, and for its own sake I’d rather not see it after the heartbreakingly excellent Tabula Rasa. Instead I will look forward to seeing more of Eyal and Behar’s work this summer at Jacob’s Pillow on their own (newly formed) company, L-E-V.
.
.
.
.
.
.
.
source: inferno-magazine
La compagnie de danse Batsheva, fondée en 1964 par Martha Graham et la baronne Bethsabée de Rothschild (surnommée «Batsheva»), fait sans conteste partie des compagnies de danse israéliennes les plus innovatrices du pays. Depuis 1990, elle est dirigée par Ohad Naharin, l’un des grands chorégraphes de ce monde.
Sharon Eyal, une danseuse qui a fait ses débuts avec Batsheva en 1990, est la chorégraphe de la maison depuis 2005. Elle est en train de créer sa propre compagnie, avec son compagnon, Gai Behar, un producteur de musique et réalisateur artistique talentueux, qui travaille avec elle sur ses spectacles depuis 2005.
Inbal Pinto a également fait ses marques avec Batsheva, avant de fonder sa propre compagnie en 1992, Inbal Pinto & Avshalom Pollak. Son compagnon, l’acteur Avshalom Pollak, chorégraphie, et dessine les costumes et les décors avec elle.
Ces excellents chorégraphes travaillent tous à l’échelle internationale. J’ai eu le bonheur d’assister à un certain nombre de spectacles créés par ces monstres sacrés de la danse contemporaine, et de les interviewer cet été à Tel Aviv. Je leur ai posé les mêmes questions, qui tournaient autour des dix mots suivants : théâtre, enfants, contraintes, costumes, couple, musique, inspiration, perception, histoires, écriture. Dans leurs réponses généreuses, ils m’ont livré des réflexions profondes sur leur façon de travailler, de créer, et d’appréhender le monde. Leur style respectif est très différent, et c’est tant mieux, mais leurs talents se rejoignent sans conteste dans l’audace, la sensualité et la poésie surréaliste, avec un côté ludique et passionné, et une pointe de provocation. À mes yeux, les créations d’Ohad Naharin mêlent mélancolie, douleur et joie ; celles de Sharon Eyal sont futuristes, tribales et hypnotiques ; et celles d’Inbal Pinto, théâtrales et tendres, ouvrent les portes de l’étrange et du fantastique. Et même si je suis à mal de décrire les mouvements des danseurs des compagnies Batsheva et Inbal Pinto & Avshalom Pollak, je peux témoigner que leurs prouesses techniques et leur expressivité extraordinaire m’ont captivée et secouée, parfois jusqu’au vertige et aux larmes.
Théâtre
Selon nos chorégraphes, la danse partage des points commun avec l’art dramatique. Pour Ohad Naharin, la danse, tout comme le théâtre, permet de mesurer explosion et délicatesse, répétition et liberté. Dans son spectacle Tabula Rasa, un classique de la danse contemporaine, créé en 1986 mais «revampé» récemment, douceur et violence trahissent la tragédie du chaos sentimental. Gai Behar rappelle qu’au-delà des mots, qui sont à son avis l’apanage du théâtre, on peut être dramatique juste dans son corps, dans ses mouvements les plus légers, et Sharon Eyal de renchérir sur le fait que même des mouvements imperceptibles des paupières ou des lèvres peuvent exprimer des sentiments dramatiques intenses dans un spectacle de danse. Par exemple, dans leur spectacle House, l’effet des danseurs grimaçant à l’unisson est saisissant.
Enfants
Inbal Pinto précise qu’en hébreu, le mot pour «jouer la comédie» signifie également jouer tout court (léssahèk), donc la danse et l’art dramatique se confondent dans cet aspect ludique. «Il s’agit d’un jeu que nous partageons avec d’autres personnes et elles participent à ce jeu, qui comporte ses règles et sa logique, mais il n’existe pas de solution unique, il en existe beaucoup». Bien évidemment, la danse, même si elle peut être art dramatique et mouvement, est beaucoup plus que cela, puisqu’elle est aussi art visuel, art musical, art de la lumière. Il est certain que les éléments du jeu, de la fantaisie et de l’imagination sont très présents dans les travaux de Pinto & Pollak, qui se réclament du monde des enfants, dont ils s’inspirent énormément car il est selon eux dénué de règles et principalement voué à l’exploration et à la surprise. Leur spectacle Oyster, d’une grande poésie, qui remplit les salles depuis treize ans et a été dansé pour la première fois à Lyon, la ville d’où je viens, met en scène des vieilles poupées cassées mises au rebut. Oyster est actuellement mis en scène à Toulouse.
Ohad Naharin, quant à lui, bien qu’il ne soit pas particulièrement inspiré par les jeux d’enfants, avoue être fasciné par les mouvements des bébés, parce qu’ils ont à voir avec l’écho, l’écho du mouvement dans leur corps. «Les danseurs les plus admirables possèdent un écho d’une grande beauté. En plus de l’écho, les mouvements des bébés sont répétitifs et cette répétition est d’une fraîcheur renouvelée, ce qui est quelque chose de très important dans la danse».
Ces enfants de Batsheva aiment jouer et se créer un monde imaginaire à eux, avec ses propres règles et contraintes. Sharon Eyal et Gai Behar se défendent cependant d’établir des règles strictes et de se plier à ce qu’ils appellent une «idéologie». Ils veulent rester ouverts et déclarent suivre routine et sautes d’humeur : celles d’Eyal, mais aussi celles d’Ori Lichtik, qui depuis huit ans crée toutes les musiques des spectacles de la chorégraphe. Pinto et Pollak préfèrent parler de cadre et de structure. Naharin établit des contraintes, qu’il va s’amuser à déconstruire ensuite. La langue du mouvement appelée «Gaga», qu’il a développée et qui est enseignée à travers le monde, comporte, outre sa technique et sa philosophie, des contraintes d’exactitude et d’efficacité, dérivées entre autres de la technique du ballet classique.
Costumes
Malgré leurs dires, Eyal et Behar ne dérogent pas d’une règle qui saute aux yeux : les costumes de leurs danseurs, dessinés par la styliste de mode Maayan Goldman, se doivent d’être extrêmement moulants et clairs, de couleur chair si possible, afin que le spectateur puisse percevoir les mouvements dans leurs plus infimes inflexions. Mais pourquoi à ce moment-là ne pas carrément dévoiler le corps, la peau, au lieu de continuer à les recouvrir de tissu ? Gai répond que le fait de montrer la chair raconte une histoire qui n’est pas la leur.
Ils rêvent d’inventer « un costume qui pourrait tout effacer »,et il leur arrive de demander aux danseurs de porter des lentilles de contact de couleur blanche. Cherchent-ils à effacer ce qu’il y a d’humain en eux ? Je pose cette question car dans les spectacles Lost Cause et House, les danseurs m’ont fait penser à une communauté d’extra-terrestres, ou d’insectes. Eyal répond qu’au contraire, le côté humain est mis en relief car sur cette toile blanche, elle ne voit plus que “le grand coeur rouge qui bat”. Behar précise qu’il s’agit plus d’une tentative d’effacer les histoires attachées aux corps. Il compare cela au fait de projeter des ombres, «tu regardes des ombres qui bougent, tu vois ce qu’il y a de dramatique dans les corps et tu n’as plus rien de familier auquel tu peux te raccrocher, quelque chose d’inattendu se produit alors, cette inquiétante étrangeté, et le public accroche».
Inbal Pinto accorde également beaucoup d’importance à ce que portent ses danseurs sur scène, même si elle ajoute que «les costumes forment un ingrédient qui n’est en aucun cas plus ou moins important que d’autres ingrédients du processus de création».
Les costumes mettent Ohad Naharin mal à l’aise : Ils ne représentent que l’emballage. Ils ont beaucoup à voir avec la forme et ne sont donc pas à mettre au même niveau que la lumière, par exemple. Quand on parle de danse, la forme et le contenu ne sont pas comme le verre et ce qu’il contient, ils ne forment qu’un. On choisit des costumes tout en sachant qu’ils pourraient être totalement différents sans pour autant affecter le reste de manière importante». Personnellement, je trouve que l’élégante sobriété des costumes de Tabula Rasacontribue à évoquer la nostalgie d’un amour passé et la tristesse qui entoure la fin de cet amour. Ces vêtements ont été dessinés par Mari Kajiwara, la feue première épouse de Naharin, ancienne danseuse de la compagnie Alvin Ailey, fauchée par un cancer à l’âge de cinquante ans en 2009
Couple
Aujourd’hui, Ohad Naharin vit à Tel Aviv avec la danseuse Eri Nakamura et leur fille de trois ans. Il ne semble pas rare que dans le monde de la danse les couples se forment à la fois dans la vie et au niveau professionnel. Sharon Eyal avoue qu’elle ne pourrait survivre sans son compagnon Gai Behar, qui considère que le monde de la danse est tellement dur et compétitif que le fait d’y évoluer en couple permet d’alléger le fardeau et de mieux s’épauler.
Musique
Tabula Rasa est le titre d’un magnifique morceau de musique d’Arvo Pärt : des violons et un piano créent l’ambiance mélancolique qui a inspiré Naharin pour la création de son spectacle. Naharin est également musicien et compositeur. Il déclare qu’« il s’agit probablement de l’exemple le plus pur de la façon dont j’utilise la musique et la danse et dont j’opère la fusion de tous les éléments. La musique d’Arvo Pärt était mon terrain de jeu. C’est l’une des rares fois où je partais de la musique ». Qu’est-ce que la musique pour la danse ? «Tout fait partie de l’offrande, de la composition. La danse ne dépend pas de la musique, le groove non plus. Si tu penses que tu as besoin de musique pour danser, tu feras un chorégraphe médiocre». La musique peut être un point de départ comme un autre pour Inbal Pinto & Avshalom Pollak, et elle inspire énormément Eyal et Behar, même si tout est réalisé en synchronie et au sein d’un ensemble, d’une composition. Leur directeur musical, Ori Lichtik, est un ami de longue date et par conséquent, comme le souligne Eyal, «la collaboration provient d’une profonde amitié, d’une histoire d’amour, et c’est ce que l’on peut avoir de mieux en termes de créativité : travailler avec des gens les yeux fermés, parce qu’il faut savoir que tu leur confies ton nouveau-né». Behar ajoute qu’« Ori Lichtik est un grand musicien qui vient de la techno. C’est aussi un batteur exceptionnel. Ce qu’il fait ressemble à de la techno tribale et cela baigne Lost Causedans une certaine transe techno, quelque chose que nous n’avions jamais fait auparavant». «Nous voulions expérimenter, relever un défi »,précise Sharon Eyal, et tu as remarqué que chaque seconde de la musique correspond à un mouvement particulier ? La danse est totalement calée sur la musique. Ce n’est par quelque chose que nous faisons habituellement, et ce n’est pas une contrainte que nous avons établie, ça s’est juste produit comme ça».
À part la musique, quelles sont leurs sources d’inspiration ? Pinto et Pollak ne sont pas forcément à la recherche de sources d’inspiration. «Tout est déjà là, les autres formes artistiques sont présentes, sous des formes différentes. Il y a quelques années nous avons réalisé un spectacle au nom d’« Hydra », basé sur les écrits de Kenji Miyazawa, qui écrivait sur les animaux». Les souvenirs personnels les inspirent, « ils font partie des choses que l’on collectionne tout au long de sa vie, on en a des valises pleines». Pollak ajoute que le sentiment de nostalgie les inspire aussi beaucoup, car appréhender le passé permet d’être plus fort pour affronter l’avenir, ainsi que la démarche de créer du nouveau à partir de l’ancien, «tout comme quand nous trouvons un vêtement dans une friperie et nous le tranformons pour obtenir quelque chose de nouveau. Gaudi ajoutait bien des vieilles céramiques à ses maisons. C’est la beauté de créer quelque chose de neuf à partir de quelque chose qui existait déjà».
Tout peut être source d’inspiration, pour Eyal et Behar, un film de David Lynch, une peinture, une conversation… Il est certain que la réalité israélienne complexe les influence aussi, mais ils ne s’en rendent pas vraiment compte.
Perception
Gai Behar raconte ceci : «Il y a huit ans nous avons montré à Montpellier le premier spectacle que nous avions réalisé ensemble. Durant la conférence de presse, les journalistes nous pressaient de leur en dire plus sur les aspects militaires de notre création. Nous n’avions pas la moindre idée de ce à quoi ils faisaient allusion, ni l’un ni l’autre n’avons fait l’armée tu sais. Ils ont juste décidé que comme nous étions israéliens, notre travail comportait nécessairement des éléments militaires. C’était absurde». Ohad Naharin pense qu’introduire des aspects explicitement politiques, sociaux ou culturels dans une chorégraphie est une faiblesse. «Même si j’ai des opinions socio-politiques très arrêtées, je n’aime pas l’idée de les transmettre par l’intermédiaire de mes danseurs, je n’ai pas besoin de voir des masques à gaz sur scène. Plus l’on s’éloigne de la réalité qui nous entoure, plus notre travail devient intime, humain, universel et éthique. Il y a une différence entre la morale et l’éthique, je préfère l’éthique, qui s’adresse à tou ». Le public se souviendra peut-être qu’en 1998 Naharin avait retiré son spectacle Anaphaza du programme de célébration des cinquante ans d’Israël parce que le président Weizman lui avait demandé d’enlever une scène que des membres de la communauté juive orthodoxe avaient trouvée obscène.
Que ressent-il quand il est assis du côté du public ? «Ce que je ressens est lié à l’interprétation des danseurs et à ce qu’ils offrent. Je n’ai nul besoin de voir ma chorégraphie, mais je veux voir le danseur, un peu de la façon dont le public le voit. Je travaille souvent avec la pensée que le public est un voyeur». Au contraire, Inbal Pinto dit ne pas penser à la réaction du public quand elle crée. Avshalom Pollak ajoute qu’ils créent quelque chose qu’ils donnent à voir à d’autres, mais au départ, ils créent pour eux-mêmes. Sharon Eyal est une spectratrice émotionnelle de ses propres créations, qui, lorsqu’elle tombe sur «des moments aussi beaux et purs que de l’or», est heureuse que son spectacle existe.
Histoires
Les chorégraphes aiment-ils raconter des histoires, créer sur des thèmes particuliers ? Sharon Eyal répond qu’« ils n’ont pas encore travaillé sur des thèmes, mais ça peut venir, un jour. Il y a tant d’histoires, juste la façon dont tu bouges est une histoire en elle-même. Nous construisons peut-être des expériences ». « Ainsi que de la musique », complète Gai Behar, « et son rythme, sa texture, les sentiments qu’elle peut générer, et au fur et à mesure une histoire se développe, même si on ne peut pas vraiment mettre le doigt dessus. Tout à coup tout est lié et les doutes s’effacent, parce tout s’accorde, alors on se dit, oui, c’est ça ». « Oui », renchérit Eyal, « c’est l’harmonie, on a un tout organique, des moments où la durée marche, où l’on sait que tous les éléments sont là, ensemble et en paix ». Une vision en partie partagée par Ohad Naharin, qui préfère parler de composition, de texture, de durée et de mouvement, plutôt que de thème, qui peut être présent mais n’est pas la chose la plus importante, « la danse doit parler de la danse, soit d’elle-même ». « On peut décrire un mouvement, mais je pense que si l’on y parvient, la chorégraphie est mauvaise. Ce que je dis peut paraître dur, mais parfois les chorégraphes sont très contents d’avoir trouvé un concept. L’art conceptuel ne m’impressionne pas, je ne suis pas contre les concepts, mais le concept ne suffit pas, et quand on décrit une histoire, on décrit un concept, et pas son odeur. On ne peut pas décrire une odeur ».Quant à Inbal Pinto, elle aime essayer de raconter des « histoires ouvertes ». Avshalom dit qu’ils offrent « des points d’ancrage et de départ. Nous aimons savoir que le spectateur se sent à l’aise». Je leur demande pourquoi ils ont choisi de raconter une histoire mettant en scène des vers à soie dans le spectacle Bombyx Mori : « Nous n’avons pas consciemment décidé de parler de vers à soie, le processus de création nous y a mené. Nous ne commençons pas à travailler à partir d’un titre ou d’un thème, nous découvrons l’histoire au fur et à mesure, sans forcer. Lorsqu’une histoire devient trop évidente, nous aimons brouiller les pistes ».
Écriture
Finalement, la question de la trace écrite, ou dessinée, interpelle les chorégraphes. Ohad Naharin éprouve le besoin d’écrire durant le processus de création. Dans le passé il écrivait énormément, même s’il ne se relisait pas forcément par la suite. Sharon Eyal et Gai Behar écrivent beaucoup également, ils ont des feuilles volantes qui traînent de partout à la maison, où sont consignées des idées et des notes prises en regardant des vidéos des répétitions. Quant à Inbal Pinto et Avshalom Pollak, ils n’écrivent pas mais dessinent : ils tiennent un journal de création qui est purement visuel, avec des schémas et des croquis, une véritable oeuvre d’art.