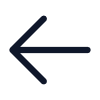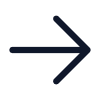Martina Bucigalupo
source: we-make-money-not-art
By cutting, embroidering and using collage, Julie Cockburn adds a psychological and sometimes even surreal layer to the vintage photographs she found in garage sales, high school yearbook portraits, cinema headshots, family mementos and landscapes.
While working in Northern Uganda, Martina Bacigalupo stopped into a photo studio to get a few shots developed. There, she noticed a standard size portrait in which the face had been cut out. The owner of the studio explained that the missing part had been used for an ID photo. When customers needed an ID head shot, he would just make a standard size portrait print from which he would stamp out the ID portrait. Bacigalupo collected all the discarded headless prints she could from the cutting room floor and created a faceless but very moving portrayal of a society which has lived through violent conflicts over several decades.
Because many people don’t own a suit but want to look smart in their photograph, the studio has one suit jacket anyone can borrow even though it might not be their size.
.
.
.
.
.
.
.
source: loeildelaphotographie
Martina Bacigalupo est une photojournaliste. Depuis 2009, ses enquêtes l’ont menée en Afrique orientale et centrale, qu’elle a parcouru du Burundi à la Somalie, en passant par l’Ouganda. Son reportage sur les conséquences des massacres perpétrés par la Lord Resistance Army de Joseph Kony pendant plus de vingt-cinq ans dans le Nord du pays lui ont valu le Prix Canon de la femme photojournaliste en 2010 et c’est en allant développer les premières images de cette douloureuse enquête dans un studio local qu’elle découvre comment rendre compte de la complexité du drame : avec une collection de portraits 10×15 aux visages minutieusement découpés qu’elle trouve dans la poubelle du photographe.
Un parcours rapide de ces documents d’identité troués évoque les portraits de studio explosant de motifs de Malick Sidibé, au Mali, ou d’Oumar Ly, au Sénégal. Il y a de cela, de l’inventaire traditionnel, dans cette galerie de tenues colorées, de fonds uniformément rouges et de corps affaissant jusqu’à le craqueler un petit banc vert en Skaï molletonné. Les expressions faciales manquent, pourtant, et les postures timides ou fermes, sages et anxieuses, suggèrent que les visages, fussent-ils visibles, seraient ici plus graves. Les rares qui ont échappé à la coupe sont muets, comme celui d’un enfant enfoui dans les genoux de sa mère, droite dans sa veste à carreaux et robe à cercles. Par indice, la galerie anonyme se transforme en étude d’une identité perforée par les balles qui ont cinglé l’air et les corps pendant des années de guerre civile, forçant à l’exode une population rurale traditionnelle. Au-delà de la métaphore, ces photographies sont le fruit des insurrections, qui ont indirectement déterminé leur format. Les innombrables réfugiés internes ont alarmé les ONG, le rythme urbain a créé de nouvelles activités nécessitant des demandes de micro-crédits, les nouveaux paradigmes démographiques imposent des projets d’infrastructure détruisant les propriétés actuelles, l’instabilité politique réclame une armée professionnelle, meme si certains jeunes recommencent a étudier au lieu de mourir. Toutes ces institutions réclament une photographie d’identité dont le format passeport, avec ses quatre poses, est un onéreux gâchis dans cette région principalement démunie par les incessants conflits. Pour réduire les couts, Raymond Okot et son fils Obal Denis ont donc commencé à extraire les visages des portraits traditionnels à prise de vue unique – lui qui, confie-t-il en fin d’ouvrage, n’aime pas recadrer les photographies. Au fil des témoignages des clients du studio compilés par Martina Bacigalupo en même temps qu’elle entassaient ces drôles de portraits, la boutique devient le théâtre de la scène locale, agora ou chacun parle ouvertement de son expérience de la guerre, de ses positions et de ses projets. Plus encore que le coiffeur du quartier, le “mzée” (le vieux, le sage en swahili) et son fils réunissent la population du Nord Ouganda dans toute sa diversité, politique et sociale, tous déterminés, que ce soit en choisissant la voie de la tradition ou celle de la modernité, à construire l’avenir. C’est ce que symbolise le père venant faire photographier son fils, chaque année depuis sa naissance, le 9 octobre – le jour de la Libération de 1962. Cela étend de 25 ans la chronologie événementielle de fin d’ouvrage et inscrit clairement le projet dans une histoire de l’Ouganda, et de la photographie ougandaise. Ce n’est pas étonnant qu’il ait attiré l’attention d’Artur Walther, qui vient juste de publier une histoire en trois tomes de la photographie africaine.
.
.
.
.
.
.
.
source: agencevu
Martina Bacigalupo was born in 1978 in Genova
She studied literature and philosophy in Italy, then photography at the London College of Printing.
In 2005 she won the prize « Black and White Photographer of the Year Award ».
She decided in 2007 to move to Burundi to try to understand and document the environment of East Africa so far away the occidental comfort we know. She worked with the United Nations, then with several international NGO like Human Rights Watch, Médecins Sans Frontières or Handicap International.
Her work is focused on the Human Rights and the witness of living conditions through the world. In 2010, she joined the Agence VU’ and won the “Prix Canon de la Femme photojournaliste” for her photo-reportage “The Resistance of the Forgotten” in Uganda.
Currently, her photographic project about the older photographic studio of Gulu District, in Uganda, the “Gulu Real Art Studio” is a resounding success. Her collection of portraits “without faces” is, for example, exhibited at the foundation Walther Collection, in New-York City and at the Rencontres d’Arles 2014 in France. Theses portraits are also gathered in a book published in 2013 by Steidl editions.